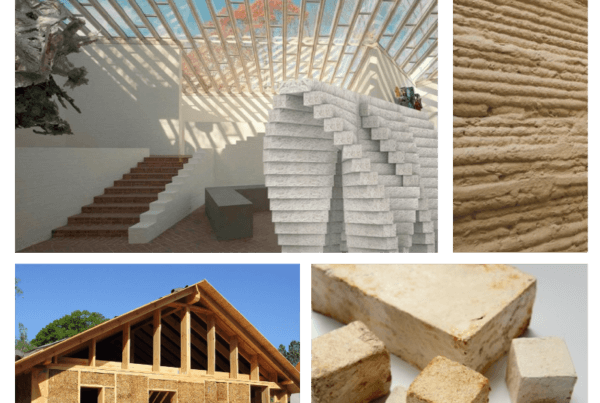”La richesse n'a de valeur que si elle est mise au service du bien commun. Celui qui meurt riche meurt en disgrâce.
Andrew CarnegieIndustriel et un philanthrope.

Andrew Carnegie : L’homme qui a fait fortune…
et qui l’a redistribuée
Andrew Carnegie, c’est un peu l’archétype du self-made-man. Parti de rien, il est devenu l’un des hommes les plus riches de son époque grâce à l’industrie de l’acier aux États-Unis. Mais ce qui le distingue vraiment des autres magnats du capitalisme, c’est ce qu’il a fait de sa fortune : il l’a donnée. Oui, littéralement. Carnegie était convaincu que l’accumulation de richesse ne servait à rien si elle n’était pas redistribuée intelligemment pour le bien commun.
L’idée de Carnegie repose sur ce qu’il appelait la « Gospel of Wealth » (ou « Évangile de la richesse »). Selon lui, être riche, ce n’est pas juste un privilège, c’est une responsabilité. Dans son essai du même nom, publié en 1889, il explique que les millionnaires ne devraient pas léguer leur fortune à leurs enfants (trop facile !), ni l’accumuler inutilement, mais plutôt l’utiliser pour améliorer la société. Il pensait que la meilleure façon d’y parvenir était d’investir dans des causes qui permettaient aux gens de s’élever par eux-mêmes : l’éducation, l’accès à la culture et la connaissance.
Concrètement, Carnegie n’a pas fait que parler, il a agi. Il a financé la construction de plus de 2 500 bibliothèques publiques à travers le monde, dont une immense majorité aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pourquoi des bibliothèques ? Parce qu’il était persuadé que l’éducation et la lecture étaient les clés de la réussite. Lui-même avait passé des heures dans une bibliothèque lorsqu’il était enfant, et il voulait offrir cette opportunité à d’autres.
Mais ce n’est pas tout ! Il a aussi investi massivement dans les universités, les écoles techniques et la recherche scientifique. Il a créé la Carnegie Mellon University, qui est aujourd’hui l’une des meilleures universités au monde. Il a également financé des centres de paix et des institutions pour promouvoir la diplomatie et éviter les guerres.
Sa philosophie de la philanthropie était claire : il ne s’agissait pas de donner de l’argent à n’importe qui, mais de l’investir dans des structures qui permettraient aux gens de s’émanciper. Selon lui, aider quelqu’un à s’en sortir par le savoir et le travail était plus efficace que de lui donner directement de l’argent.
Bien sûr, tout le monde n’était pas d’accord avec lui. Certains trouvaient hypocrite qu’il parle de justice sociale alors qu’il avait bâti sa fortune sur l’exploitation des ouvriers dans ses aciéries. D’autres estimaient qu’il aurait dû mieux payer ses employés au lieu de financer des bibliothèques… Et c’est vrai que le personnage était complexe, entre businessman impitoyable et philanthrope visionnaire.
Quoi qu’il en soit, son impact est encore visible aujourd’hui. Les bibliothèques Carnegie existent toujours, son université forme des milliers d’étudiants chaque année, et ses idées ont influencé d’autres milliardaires modernes comme Bill Gates et Warren Buffett, qui prônent une philanthropie active.
Au final, Andrew Carnegie a prouvé qu’il était possible d’amasser une immense fortune… et de la redonner pour le bien de la société. Une approche qui fait réfléchir sur la responsabilité des grandes fortunes d’aujourd’hui.